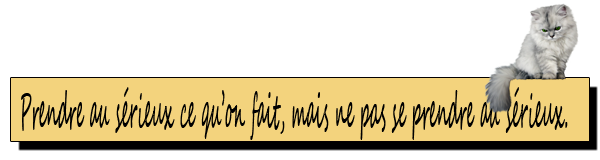[Idée] Arbalète
Re: [Idée] Arbalète
Comme il a été dit plus haut Beth a probablement prévu de le faire... Ce qui rendra le travail sur de futures arbalètes déjà plus simple... Ne serait-ce que pour la vue à la première personne qui "réagit" à la préparation de l'arme.
La plus pure des gentillesses est de ne pas être gentil

Commettre une erreur et ne pas réviser son jugement est ce qu'on appelle une erreur.
Re: [Idée] Arbalète
Je vous conseil, pour les anglophones, de lire le lien vers les forums de bethesda, c'est extrêmement intéressant!
Adieu Yu Qi...
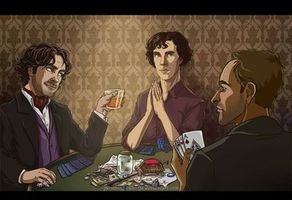
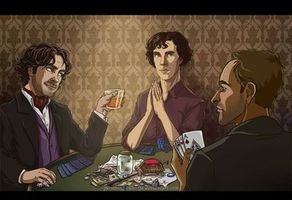
Re: [Idée] Arbalète
Saphaniax, tu as sans aucun doute la meilleure prof de l'univers, je ne vais pas contester cela, après tout je ne la connais pas. Je ne suis pas buté et je ne défends pas une position sans raison, je t'ai donné les miennes. Toi tu te contente de dire : "Non c'est pas ça ! " Et lorsque tu te lances dans une argumentation, tu confonds l'Empire Carolingien et le Saint Empire Romain Germanique ! Comment veux-tu me convaincre ?
Le terme armure de fer était à la fin du Moyen-âge utilisé pour désigner n'importe quel homme d'arme à pied ou à cheval. Il fut utilisé depuis l'époque de Charles VII jusqu'au XVIème siècle.
Très synthétiquement, l'histoire de l'armure (faites de pièces métalliques articulées) commence en 1250, lorsque - au heaume- on adjoint deux plaques de métal quadrangulaire (les ailettes) nouées sur les épaules et reliées au heaume. Le but était de garantir le chevalier, encore en cotte de maille, des coups de masse qui pouvaient défoncer son heaume.
Vers 1300, les premières pièces d'armure viennent renforcer cotte de mailles et broignes. Outre les ailettes utilisées depuis 50 ans, les arrières bras sont armées de plaque de fer et les coudes de cubitières coniques. Les jambes sont protégées par des grèves et de genouillères. Progressivement, les pièces d'armures vont se rejoindre et former l'armure la plus lourde de l'époque médiévale : l'armure de mailles et de plaque. C'est à dire une armure formée d'une cotte de maille ou d'une broigne par-dessus laquelle est portée des plaques de métal.
D'après le Pélerinage de la vie humaine de Guillaume de Digulleville (XIIIème siècle)http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Digulleville :
Là sont heaumes et habergeons
Gorgerites et gambesons
Targes et quanques faillir puet
A cil qui deffendre se veult
(...)
Adonc prist-elle un gambeson
D'une desguisée façon
(...)
Car droit derrière estoit mise
En la dossière et assise
Une enclume qui faite estoit
pour corps de martiaux recevoir
Or, le roman est illustré et sur des perches ont voit pendus les armures des chevaliers. On ne peut donc douter du fait qu'à l'époque l'armure était constitué de trois couches : un gambisson de tissu matelassé, une cotte de maille et par-dessus des pièces divers dont un gorgerin, pièces métalliques protégeant la gorge et qui servait surtout à articuler le heaume et à le relier aux plaques thoraciques. La mention d'une enclume explique bien en quoi sont faites les pièces d'armures de l'époque en fer ! L'acier ne se peut travailler qu'au laminoir !
L'armure d'acier apparaît dès le XIVème siècle, toutefois les armures de plates sont à l'époque usitées uniquement par les plus riches. Les combattants communs porte encore "l'uniforme" des soldats médiévaux : le haubergeon de maille, le gambison ou la broigne, recouvert d'une cotte d'arme portant les armes de leur seigneur.
L'armure de plate complète n'existe toutefois pas encore, la plupart des combattants du Moyen-Âge portent encore des pièces d'armures (d'acier ou de fer) lacées sur un gambisson. Les pièces trop difficiles à faire en plaques sont alors en maille. Comme au siècle précédent, les armures mélangent plaques, cuir et maille. la nouveauté c'est que les combattants les plus riches portent des plaques d'acier. Elles sont fabriquées grâce à un laminoir c'est à dire un système de rouleaux qui écrase les plaque d'acier pour les transformer en tôle http://fr.wikipedia.org/wiki/Laminage. le laminage change le volume de l'acier mais non son poids. Nous le verrons par la suite, c'est très important.
Vers 1340 la cotte d'arme perd son caractère flottant. Cette évolution est dû a un accident tragique, hélas commun. La cotte d'arme frappé du blason d'un seigneur a d’abord été développé pour empêcher le soleil de taper sir les armures et ainsi préserver un peu leur porteur de se déplacer dans leurs rôtissoires personnelles. Toutefois, il arrivait lors d'une charge de cavalerie, qu'un cavalier démonté voit les pans de cette longue "robe" s'accrocher au harnachement de son cheval et soit traîné à terre.
En 1346, à l'époque de Crécy, l'armure de plaque est enfin née. Pas de plaque thoracique à cette époque (le corselet n'est pas encore né). On porte une cotte de maille sur la poitrine et par dessus une sur-cotte de peau fortement rembourrée qui sert au corps et qui est lacée dans le dos. Bras et jambes sont par contre protégées de plaques articulées en acier. Toutefois, ces armures ne sont pas représentatives de tout ce qui se faisait à l'époque. Le gisant du d'Ulrik, langrave d'Alsace, dans le choeur de l’église Saint-Guillaume de Strasbourg est composée de mailles SUR des plaques, elles-mêmes recouvertes par une dalmatique flottante... abandonnée en France à la même époque.
J'espère que l'on me pardonnera un saut temporel de près de 50 ans, mais l'évolution de l'armure reste peu intéressante. En 1390, l'armure est certes plus ajustée au cors, mais elle est constituée toujours du même mélange d'acier, de cuir et de maille. l'apparition des solerets, des chaussures de plaques pour protéger le pied permet de le mieux protéger. c'est surtout l'apparition du corselet d'acier qui change tout. Il s'agit d'une protection articulée ( en trois parties : dossière, pansière, plastron) qui protège la poitrine sans (trop) restreindre le mouvement.
En 1400, la chevalerie française adopte définitivement l'armure de plaque ou harnois blanc, c'est à dire simplement poli qui reste pour nous l'armure du chevalier. Le bacinet remplace le heaume - qui ne sert dès lors plus qu'au tournoi- grâce au corselet on peut à présent relier ensemble toutes les pièces d'armure ce qui fait disparaître les mailles pratiquement sur toute l'armure, elles ne restent présentes qu'à l'articulation des bras et... euh... à un endroit qu'il serait peu convenable de décrire, mais qui recouvert de plaque transformerait le séjours sur la fosse d'aisance un véritable supplice en cas de besoin pressant !
Les historiens estiment que le harnois blanc a été inspiré par le jeu des plaques de la queue de l'écrevisse. Cependant, ces chevaliers en très lourde armures livraient un combat d'arrière garde perdue d'avance, même couverts de fer ou d'acier (les deux types d'armures se côtoient encore) que pouvaient les chevaliers contre l'arbalète, la vouge, la plomée et le fauchard! ? Lorsque les chevaliers devaient combattre à pied, peu mobiles, promptement épuisés, ils ne pouvaient soutenir une longue lutte.
La guerre de cent ans, opposaient une chevalerie -qui combattait à la lance courte et à la masse d'arme- à une infanterie d'archers qui pouvaient à 300 pas tuer d'une flèche un chevalier bien mieux né que lui.
Le livre de Guryon le courtois, manuscrit de 1400 conservé à la bibliothèque nationale, montre des chevaliers entièrement en plates et dépourvu de toute protection de maille.
Cependant, le corselet restait une pièce d'armure très difficile à fabriquer. Le manuscrit Les merveilles du monde écris vers 1404 et conservé à la bibliothèque nationale montre des hommes d'armes portant encore des protections de poitrines en mailles.
Il est à remarquer que les défaites françaises contribuent beaucoup à la standardisation des équipements et à l'abandon des cottes d'armes gênantes. Elles expliquent notamment que bon nombre de nobles français morts à Azincourt en 1419 ne furent pas reconnus. Le duc d'Alençon lui-même, blessé par l'Anglais dut soulever sa visière et se nommer mais ne fut pas pour autant épargné car il ne fut pas reconnu.
Le pays ruiné, sa chevalerie décimée, la France dut à nouveau reconstituer son armée. Conséquence positive, le pays s'ouvrit aux influences de la Bourgogne, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Italie au niveau de l'armement. La chevalerie, brisée, écrasée, fut remplacée par la nation en arme. Ce fut la naissance du nationalisme et la fin de la féodalité. Charles VII, roi injustement sous-estimé, créa la première armée permanente de l'histoire de France, l'organisant par ville et par région et non par domaine. Il dota cette armée de la première artillerie de campagne de son époque.
Les armures utilisées en France à cette époque étaient des armures d'acier.
L'armure de fer de Pierrefond datant de 1440 et conservé à présent au musée de l'Artillerie de Paris. Comme nombre d'armure d'acier, elle est moulée exactement sur son porteur ce qui permet de ne pas le gêner dans ces mouvements. Le grand avantage est que l'on éprouve nul gêne et que les mouvements peuvent s'enchaîner librement. le poids même de ces harnois est peu sensible parce qu'il est réparti sur tout le corps. L'armure de Pierrefonds ne pèse que 25 kg ! Et est composé de feuilles d'acier battues, très minces mais très résistantes. Le métal, écrouis a acquis une fermeté et une résistante exceptionnelle.
A cette époque, les fabriques d'armes les plus renommées étaient Milan, Pavie (renommée depuis le XIIème siècle); Arras, Gand, Nuremearg.
Il n'existe que peu d'armures de fer françaises dans les musées français. La plupart viennent d'Allemagne où elles sont fabriquées à partir de 1450.
Catherine de Pisan, dans Le livre des faits et des bonnes meurs du sage roy Charles nous apprend que Charles V se faisait déjà livrer des armures de Milan. C'est sans doute par ce biais qu'arrivèrent en France les premières armures de fer battu qui sont invention milanaise.
Elles furent inventée au XVème siècle et perfectionnées au XVIème, elles sont l'aboutissement ultime de l'armure de plates. Milan était renommée pour leur fabrication. Plus légères que les armures d'acier fabriquées en France, elles étaient aussi considérées comme plus solide. Toutefois, c'est en Allemagne, à Nuremberg, que les armuriers adoptèrent l'utilisation des nerfs saillants et des cannelures pour les habillements de fer. Ainsi sans augmenter le poids de l'armure on augmentait la résistance de l'armure.
L'armure de Nuremberg avait ainsi une dossière forgée d'un grand nombre de canelures concaves qui laissaient une cannelure entre chacun d'eux. Les armures dites maximiliennes , de la fin du XVème siècle, possèrent ce principe dans ses derniers retranchements.
Le harnois de Milan est ainsi décrit dans le manuscrit "du costume militaire des français en 1446 : " clos davant et derrière par le bas, ainsi que on le fait à Milan, et à grandes gardes au genouil, et ung pou de mailles sur le cou du pié; et l'autre faczon du harnoys de jambes est tout pareil à l'autre cy dessus déclairé, sinon entrant que par la jambe bas s'en fault trois doiz que ne soit cloz, et ont les gardes plus petites en droit le genouil."
Vers 1470, on commence à copier en France l'armure maximilienne que l'on importait d'Allemagne depuis près de 20 ans. Toutefois, les cannelures ne furent jamais utilisées dans les armures françaises. Trop difficiles à créer et trop chères pour le commun des gens d'armes. Il est à remarquer qu'il y a un autre avantage au armure de fer sur les armures d'acier. En effet, leurs tassettes ont une profonde échancrure à l'entre-cuisses. Moins lourdes, elles ne nécessitent pas de se tenir debout dans ses étriers. On a donc pas beoins d'une selle à haut dossier. Les cuissots ne sont donc plus articulés que dans leur partie supérieure, et les grèves ne sont que d'une seule pièce sur le devant. plus besoin non plus de sorelets à bout courbes pour rester en selle. le bout est donc carré et facilite la marche au sol...
Je pense que je peux m'arrêter là !
Le terme armure de fer était à la fin du Moyen-âge utilisé pour désigner n'importe quel homme d'arme à pied ou à cheval. Il fut utilisé depuis l'époque de Charles VII jusqu'au XVIème siècle.
Très synthétiquement, l'histoire de l'armure (faites de pièces métalliques articulées) commence en 1250, lorsque - au heaume- on adjoint deux plaques de métal quadrangulaire (les ailettes) nouées sur les épaules et reliées au heaume. Le but était de garantir le chevalier, encore en cotte de maille, des coups de masse qui pouvaient défoncer son heaume.
Vers 1300, les premières pièces d'armure viennent renforcer cotte de mailles et broignes. Outre les ailettes utilisées depuis 50 ans, les arrières bras sont armées de plaque de fer et les coudes de cubitières coniques. Les jambes sont protégées par des grèves et de genouillères. Progressivement, les pièces d'armures vont se rejoindre et former l'armure la plus lourde de l'époque médiévale : l'armure de mailles et de plaque. C'est à dire une armure formée d'une cotte de maille ou d'une broigne par-dessus laquelle est portée des plaques de métal.
D'après le Pélerinage de la vie humaine de Guillaume de Digulleville (XIIIème siècle)http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Digulleville :
Là sont heaumes et habergeons
Gorgerites et gambesons
Targes et quanques faillir puet
A cil qui deffendre se veult
(...)
Adonc prist-elle un gambeson
D'une desguisée façon
(...)
Car droit derrière estoit mise
En la dossière et assise
Une enclume qui faite estoit
pour corps de martiaux recevoir
Or, le roman est illustré et sur des perches ont voit pendus les armures des chevaliers. On ne peut donc douter du fait qu'à l'époque l'armure était constitué de trois couches : un gambisson de tissu matelassé, une cotte de maille et par-dessus des pièces divers dont un gorgerin, pièces métalliques protégeant la gorge et qui servait surtout à articuler le heaume et à le relier aux plaques thoraciques. La mention d'une enclume explique bien en quoi sont faites les pièces d'armures de l'époque en fer ! L'acier ne se peut travailler qu'au laminoir !
L'armure d'acier apparaît dès le XIVème siècle, toutefois les armures de plates sont à l'époque usitées uniquement par les plus riches. Les combattants communs porte encore "l'uniforme" des soldats médiévaux : le haubergeon de maille, le gambison ou la broigne, recouvert d'une cotte d'arme portant les armes de leur seigneur.
L'armure de plate complète n'existe toutefois pas encore, la plupart des combattants du Moyen-Âge portent encore des pièces d'armures (d'acier ou de fer) lacées sur un gambisson. Les pièces trop difficiles à faire en plaques sont alors en maille. Comme au siècle précédent, les armures mélangent plaques, cuir et maille. la nouveauté c'est que les combattants les plus riches portent des plaques d'acier. Elles sont fabriquées grâce à un laminoir c'est à dire un système de rouleaux qui écrase les plaque d'acier pour les transformer en tôle http://fr.wikipedia.org/wiki/Laminage. le laminage change le volume de l'acier mais non son poids. Nous le verrons par la suite, c'est très important.
Vers 1340 la cotte d'arme perd son caractère flottant. Cette évolution est dû a un accident tragique, hélas commun. La cotte d'arme frappé du blason d'un seigneur a d’abord été développé pour empêcher le soleil de taper sir les armures et ainsi préserver un peu leur porteur de se déplacer dans leurs rôtissoires personnelles. Toutefois, il arrivait lors d'une charge de cavalerie, qu'un cavalier démonté voit les pans de cette longue "robe" s'accrocher au harnachement de son cheval et soit traîné à terre.
En 1346, à l'époque de Crécy, l'armure de plaque est enfin née. Pas de plaque thoracique à cette époque (le corselet n'est pas encore né). On porte une cotte de maille sur la poitrine et par dessus une sur-cotte de peau fortement rembourrée qui sert au corps et qui est lacée dans le dos. Bras et jambes sont par contre protégées de plaques articulées en acier. Toutefois, ces armures ne sont pas représentatives de tout ce qui se faisait à l'époque. Le gisant du d'Ulrik, langrave d'Alsace, dans le choeur de l’église Saint-Guillaume de Strasbourg est composée de mailles SUR des plaques, elles-mêmes recouvertes par une dalmatique flottante... abandonnée en France à la même époque.
J'espère que l'on me pardonnera un saut temporel de près de 50 ans, mais l'évolution de l'armure reste peu intéressante. En 1390, l'armure est certes plus ajustée au cors, mais elle est constituée toujours du même mélange d'acier, de cuir et de maille. l'apparition des solerets, des chaussures de plaques pour protéger le pied permet de le mieux protéger. c'est surtout l'apparition du corselet d'acier qui change tout. Il s'agit d'une protection articulée ( en trois parties : dossière, pansière, plastron) qui protège la poitrine sans (trop) restreindre le mouvement.
En 1400, la chevalerie française adopte définitivement l'armure de plaque ou harnois blanc, c'est à dire simplement poli qui reste pour nous l'armure du chevalier. Le bacinet remplace le heaume - qui ne sert dès lors plus qu'au tournoi- grâce au corselet on peut à présent relier ensemble toutes les pièces d'armure ce qui fait disparaître les mailles pratiquement sur toute l'armure, elles ne restent présentes qu'à l'articulation des bras et... euh... à un endroit qu'il serait peu convenable de décrire, mais qui recouvert de plaque transformerait le séjours sur la fosse d'aisance un véritable supplice en cas de besoin pressant !
Les historiens estiment que le harnois blanc a été inspiré par le jeu des plaques de la queue de l'écrevisse. Cependant, ces chevaliers en très lourde armures livraient un combat d'arrière garde perdue d'avance, même couverts de fer ou d'acier (les deux types d'armures se côtoient encore) que pouvaient les chevaliers contre l'arbalète, la vouge, la plomée et le fauchard! ? Lorsque les chevaliers devaient combattre à pied, peu mobiles, promptement épuisés, ils ne pouvaient soutenir une longue lutte.
La guerre de cent ans, opposaient une chevalerie -qui combattait à la lance courte et à la masse d'arme- à une infanterie d'archers qui pouvaient à 300 pas tuer d'une flèche un chevalier bien mieux né que lui.
Le livre de Guryon le courtois, manuscrit de 1400 conservé à la bibliothèque nationale, montre des chevaliers entièrement en plates et dépourvu de toute protection de maille.
Cependant, le corselet restait une pièce d'armure très difficile à fabriquer. Le manuscrit Les merveilles du monde écris vers 1404 et conservé à la bibliothèque nationale montre des hommes d'armes portant encore des protections de poitrines en mailles.
Il est à remarquer que les défaites françaises contribuent beaucoup à la standardisation des équipements et à l'abandon des cottes d'armes gênantes. Elles expliquent notamment que bon nombre de nobles français morts à Azincourt en 1419 ne furent pas reconnus. Le duc d'Alençon lui-même, blessé par l'Anglais dut soulever sa visière et se nommer mais ne fut pas pour autant épargné car il ne fut pas reconnu.
Le pays ruiné, sa chevalerie décimée, la France dut à nouveau reconstituer son armée. Conséquence positive, le pays s'ouvrit aux influences de la Bourgogne, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Italie au niveau de l'armement. La chevalerie, brisée, écrasée, fut remplacée par la nation en arme. Ce fut la naissance du nationalisme et la fin de la féodalité. Charles VII, roi injustement sous-estimé, créa la première armée permanente de l'histoire de France, l'organisant par ville et par région et non par domaine. Il dota cette armée de la première artillerie de campagne de son époque.
Les armures utilisées en France à cette époque étaient des armures d'acier.
L'armure de fer de Pierrefond datant de 1440 et conservé à présent au musée de l'Artillerie de Paris. Comme nombre d'armure d'acier, elle est moulée exactement sur son porteur ce qui permet de ne pas le gêner dans ces mouvements. Le grand avantage est que l'on éprouve nul gêne et que les mouvements peuvent s'enchaîner librement. le poids même de ces harnois est peu sensible parce qu'il est réparti sur tout le corps. L'armure de Pierrefonds ne pèse que 25 kg ! Et est composé de feuilles d'acier battues, très minces mais très résistantes. Le métal, écrouis a acquis une fermeté et une résistante exceptionnelle.
A cette époque, les fabriques d'armes les plus renommées étaient Milan, Pavie (renommée depuis le XIIème siècle); Arras, Gand, Nuremearg.
Il n'existe que peu d'armures de fer françaises dans les musées français. La plupart viennent d'Allemagne où elles sont fabriquées à partir de 1450.
Catherine de Pisan, dans Le livre des faits et des bonnes meurs du sage roy Charles nous apprend que Charles V se faisait déjà livrer des armures de Milan. C'est sans doute par ce biais qu'arrivèrent en France les premières armures de fer battu qui sont invention milanaise.
Elles furent inventée au XVème siècle et perfectionnées au XVIème, elles sont l'aboutissement ultime de l'armure de plates. Milan était renommée pour leur fabrication. Plus légères que les armures d'acier fabriquées en France, elles étaient aussi considérées comme plus solide. Toutefois, c'est en Allemagne, à Nuremberg, que les armuriers adoptèrent l'utilisation des nerfs saillants et des cannelures pour les habillements de fer. Ainsi sans augmenter le poids de l'armure on augmentait la résistance de l'armure.
L'armure de Nuremberg avait ainsi une dossière forgée d'un grand nombre de canelures concaves qui laissaient une cannelure entre chacun d'eux. Les armures dites maximiliennes , de la fin du XVème siècle, possèrent ce principe dans ses derniers retranchements.
Le harnois de Milan est ainsi décrit dans le manuscrit "du costume militaire des français en 1446 : " clos davant et derrière par le bas, ainsi que on le fait à Milan, et à grandes gardes au genouil, et ung pou de mailles sur le cou du pié; et l'autre faczon du harnoys de jambes est tout pareil à l'autre cy dessus déclairé, sinon entrant que par la jambe bas s'en fault trois doiz que ne soit cloz, et ont les gardes plus petites en droit le genouil."
Vers 1470, on commence à copier en France l'armure maximilienne que l'on importait d'Allemagne depuis près de 20 ans. Toutefois, les cannelures ne furent jamais utilisées dans les armures françaises. Trop difficiles à créer et trop chères pour le commun des gens d'armes. Il est à remarquer qu'il y a un autre avantage au armure de fer sur les armures d'acier. En effet, leurs tassettes ont une profonde échancrure à l'entre-cuisses. Moins lourdes, elles ne nécessitent pas de se tenir debout dans ses étriers. On a donc pas beoins d'une selle à haut dossier. Les cuissots ne sont donc plus articulés que dans leur partie supérieure, et les grèves ne sont que d'une seule pièce sur le devant. plus besoin non plus de sorelets à bout courbes pour rester en selle. le bout est donc carré et facilite la marche au sol...
Je pense que je peux m'arrêter là !
L'honneur n'est qu'un bien personnel, le plus précieux, certes. Mais l'honneur n'est pas une qualité pour l'exercice de cet art délicat qu'est la guerre.
Re: [Idée] Arbalète
Re: [Idée] Arbalète
Prosternez vous avec moi devant cet être parfait de connaissance! 



Adieu Yu Qi...
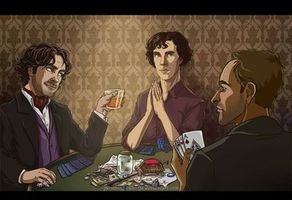
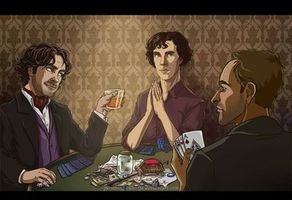
Re: [Idée] Arbalète
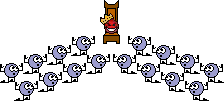 Il faut que je te présente mon oncle, vous vous entendriez bien !
Il faut que je te présente mon oncle, vous vous entendriez bien !Re: [Idée] Arbalète
L'honneur n'est qu'un bien personnel, le plus précieux, certes. Mais l'honneur n'est pas une qualité pour l'exercice de cet art délicat qu'est la guerre.
Re: [Idée] Arbalète
Merci du paté Malhuin  Concrètement je ne confond pas le st empire germanique et l'empire carolingien, je te remercie mais j'en ai baver suffisamment à la fac dessus pour savoir qui est quoi
Concrètement je ne confond pas le st empire germanique et l'empire carolingien, je te remercie mais j'en ai baver suffisamment à la fac dessus pour savoir qui est quoi  Si tu ne me crois pas à ton aise, mais je suis faignant et j'ai pas envie non plus de pondre un paté
Si tu ne me crois pas à ton aise, mais je suis faignant et j'ai pas envie non plus de pondre un paté  Donc à l'inverse je te renvoi à un bon vieux bouquin d'histoire politique de l’Europe de l'ouest.
Donc à l'inverse je te renvoi à un bon vieux bouquin d'histoire politique de l’Europe de l'ouest.
Sinon j'applaudis Mais comprend que depuis le dépars je ne discute que chronologie
Mais comprend que depuis le dépars je ne discute que chronologie 
 Effectivement je ne la pensait pas si tardive, mais malgré tout je m’interroge effectivement sur la composition des armures vers la guerre de 100 ans et même avant. Les propriétés mécaniques de l'acier vis à vis du fer sont et même en Europe reconnue très tôt. Donc oui elles devaient être très chère et réserver aux suzerain en général .Mais je serais étonné qu'elles aient été abandonnées plus longtemps et que les propriétés de ce matériau n'ai pas été usé lors de l’émergence du féodalisme.
Effectivement je ne la pensait pas si tardive, mais malgré tout je m’interroge effectivement sur la composition des armures vers la guerre de 100 ans et même avant. Les propriétés mécaniques de l'acier vis à vis du fer sont et même en Europe reconnue très tôt. Donc oui elles devaient être très chère et réserver aux suzerain en général .Mais je serais étonné qu'elles aient été abandonnées plus longtemps et que les propriétés de ce matériau n'ai pas été usé lors de l’émergence du féodalisme.
Surtout que d'éventuel possesseurs sont rarement ceux qui vont sur le front.
C'est un peu comme les constructions romaines. Par les reconstitution jusqu'à maintenant réaliser ,on est encore à se demander comment avec leur propres techniques ils arrivaient à tenir la cadence vis à vis de leurs prouesses techniques ... Le moyen âge ce n'est pas mieux.. Cependant je partage ton avis vis à vis des arbalettes quand à leur usages sur le terrain, mais je ne pense pas non plus que leur usage fut forcément systématique.
 Je fais juste un parallèle des techniques militaires vis à vis du contexte historique . Hors c'est toi qui me parle du st empire germanique , certes il à duré longtemps mais il est apparus malgré tout aussi très tôt . Et désoler de te l'apprendre mais son histoire est liée à la fin de l'empire carolingien . Réponse à ta question subliminale : Oui je suis un emmerdeur
Je fais juste un parallèle des techniques militaires vis à vis du contexte historique . Hors c'est toi qui me parle du st empire germanique , certes il à duré longtemps mais il est apparus malgré tout aussi très tôt . Et désoler de te l'apprendre mais son histoire est liée à la fin de l'empire carolingien . Réponse à ta question subliminale : Oui je suis un emmerdeur  à bon entendeurs !
à bon entendeurs !
Sinon j'applaudis
Surtout que d'éventuel possesseurs sont rarement ceux qui vont sur le front.
ta ta ta tu n'en sais rien et moi non plus. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui encore les historiens réalisent encore et encore des reconstitutions. Sans compter que ceux qui sont sur le terrain sont à cette époque des gens d'arme et qui en tant que véritable caste sont entrainer au combat.que pouvaient les chevaliers contre l'arbalète, la vouge, la plomée et le fauchard! ? Lorsque les chevaliers devaient combattre à pied, peu mobiles, promptement épuisés, ils ne pouvaient soutenir une longue lutte.
C'est un peu comme les constructions romaines. Par les reconstitution jusqu'à maintenant réaliser ,on est encore à se demander comment avec leur propres techniques ils arrivaient à tenir la cadence vis à vis de leurs prouesses techniques ... Le moyen âge ce n'est pas mieux.. Cependant je partage ton avis vis à vis des arbalettes quand à leur usages sur le terrain, mais je ne pense pas non plus que leur usage fut forcément systématique.
On va essayer de rester courtois si tu veux bien, je ne t'ai pas contredis nécessairementJe ne suis pas buté et je ne défends pas une position sans raison, je t'ai donné les miennes. Toi tu te contente de dire : "Non c'est pas ça ! "