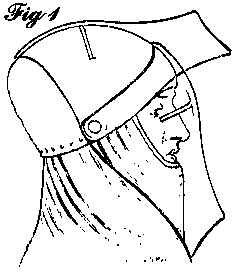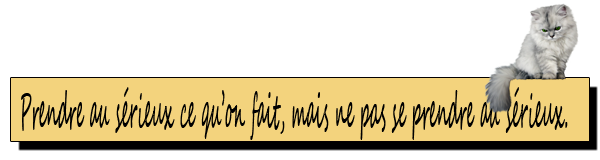Pour mon roman "Marie la Juive", j'ai reconstitué deux batailles médiévales du XVème siècle: La bataille de la Birse et la bataille de Formigny. Elles sont du moyen-âge tardif, à une époque où les armures sont déjà bien plus évoluées. Mais cela devrait vous donner une bonne idée de ce qu'étaient les batailles médiévales.
► Afficher le texte
La bataille de la Birse (voir note 15, page 75)
Le dauphin Louis avait envoyé les cavaliers et les archers de Bueil devant Bâle dans l’espoir que la garnison fit une sortie. Le gros de l’armée devait en profiter pour prendre la ville.
Initialement, la stratégie fonctionna. Un contingent de 2 500 défenseurs sortit de la ville de Bâle pour livrer bataille à la troupe française, pourtant cinq fois plus nombreuse. L’affrontement eut lieu sur le plateau de la Birse et n’aurait pu être plus violent. Les Helvètes formaient une infanterie lourde vêtue de mailles et casquée de fer. Leur phalange était réputée pour sa résistance à la cavalerie. Alors que leurs premières lignes se hérissaient en une haie de piques capable d’arrêter une charge lourde, les hommes placés derrière massacraient les cavaliers immobilisés avec leurs redoutables hallebardes et autres Morgenstern (bâtons garnis de pointes). En dépit de leur férocité et des pluies de flèches décochées par leurs archers, les redoutables écorcheurs furent incapables de triompher. Ils attaquèrent continuellement pendant une bonne partie de la matinée, en vain.
Voyant que le contingent qui avait attaqué de Bueil était en difficulté, les portes de Bâle s’ouvrirent une nouvelle fois pour faire sortir un secours de plusieurs milliers de défenseurs.
C’était le moment qu’attendait le dauphin pour intervenir selon le plan qu’il avait arrêté. Alors que la cavalerie mobilisait les Suisses, il s’avança vers Bâle à présent sans défense. Cependant, sa manœuvre ne passa pas inaperçue des renforts. Les Bâlois comprirent qu’ils avaient été joués. Ils firent demi-tour et regagnèrent la ville avant l’arrivée de l’héritier du trône.
La retraite des Bâlois provoqua un fort mouvement d’inquiétude parmi les Suisses engagés contre la cavalerie. S’avisant enfin qu’ils affrontaient une armée très supérieure en nombre, ils voulurent regagner la ville. De Bueil mit à profit leur perte de cohésion pour les assaillir à coup redoublé et les tailler en pièce. Une partie des troupes n’en réussit pas moins à se réfugier dans l’Hospice Saint-Jacques.
Après avoir subi de telles pertes, les Ecorcheurs étaient à présent ivres de rage. De Bueil fit donner l’artillerie jusqu’à ce que la léproserie ne fût plus qu’un amas de décombre. Les Routiers- à présent démontés- s’élancèrent ensuite à l’attaque et affrontèrent les Suisses survivants au corps au corps. La mêlée fut acharnée et continua jusqu’au soir. Les pertes furent terribles. 4000 Français et alliés périrent, dont Robert de Brézé, le frère du ministre du roi, et Burckhardt Munch, le commandant de la cavalerie autrichienne. Seuls deux cent Suisses – tous grièvement blessés- regagnèrent Bâle. Aucun ne recula, aucun ne se rendit. Ils tinrent le serment qu’ils avaient prononcé la veille de la bataille : Ils avaient rendus leurs âmes à Dieu et leurs corps aux Ecorcheurs.
Un tel engagement eut bien sûr des conséquences à sa mesure. Certes, les Suisses venaient d’essuyer une défaite. Obligés de lever les sièges de Zurich et de Farnbourg, ils rallièrent toutes leurs troupes pour défendre leurs foyers. Cependant, la victoire du dauphin avait eu lieu dans de telles circonstances que le prestige des Cantons en ressortait grandi plutôt que diminué.
La tentative de Coup d’état du Dauphin Louis (voir note 40 p 216)
Après avoir vainement combattu l’emprise de Pierre de Brézé sur la Cour du roi, en 1446, Louis change de tactique. Il cherche à se rapprocher de lui et échoue. Ses conseils et ses plans, systématiquement rejetés par son père, Louis se tourne vers une action plus directe. On ne sait pas s’il tenta un réel coup d’état contre son père, en tout cas il en démontra la faisabilité devant Antoine de Chabannes. Lorsque le roi eut des échos de ce qui se passait il convoqua son fils qui accusa immédiatement Chabannes d’être le seul instigateur. Il accusa aussi Pierre de Brézé. Convoqué, Chabannes témoigna que c’est le prince qui lui avait parlé de cette affaire et que lui ne l’avait pas prise au sérieux. Pour prouver sa bonne foi, il demanda à affronter tout champion que le dauphin daignerait à désigner pour le représenter. Le duel n’eut pas lieu. A quelques temps de là, Louis gifla Agnès Sorel ou – selon les versions- la poursuivit l’épée à la main jusque dans la chambre du roi. Cette fois les choses étaient allées trop loin. Le roi gardait le dauphin près de lui pour le surveiller mais sa conduite était par trop inconvenante et dangereuse. Il l’éloigna donc dans son apanage du Dauphiné. Il était sensé y rester que quelques mois. En fait, le père et le fils ne se reverront jamais. Louis transforma le Dauphiné de manière à en faire l’état le plus moderne d’Europe. De là, il lança une campagne satyrique contre son père…
De son côté, Chabannes resta près du roi qui lui accorda sa confiance pour lui avoir montré la conspiration du dauphin. Quand à Pierre de Brézé – lui aussi éclaboussé par cette affaire- il manqua d’être démis mais garda sa fonction, il perdit cependant une partie de son influence.
Si la réalité de cette affaire ne peut être mise en doute, nul ne peut dire qu’elles étaient réellement les intentions du dauphin. La seule version de cette histoire à avoir traversé le temps est le témoignage de Chabannes, fait à l’époque où il avait abandonné le parti du dauphin pour celui du roi. Un tel témoignage –politique- est sujet à caution.
Toutefois, pour ma part, je pense que le dauphin voulait réellement prendre le pouvoir. Après tout il avait déjà tenté d’entrer en révolte ouverte dix ans plus tôt (la Praguerie) et essaya encore deux fois de déstabiliser son père depuis le Dauphiné, puis au côté de son oncle le duc de Bourgogne.
La bataille de Formigny (voir note 43, page 233)
L’armée anglaise, commandée par Thomas Kyriel est forte de 4000 à 5000 hommes. Elle représente tout ce que le roi d’Angleterre est capable de rassembler étant donné ses difficultés financière. En face, l’armée du comte de Clermont comprend de nombreux noms célèbres dont Jacques de Chabannes et Pierre de Brézé. Mais elle n’est forte que de 3000 hommes.
Habitués à remporter des victoires écrasantes sur les Français, les Anglais avaient fini par devenir insolents et hautains. Entre eux ne disaient-ils pas « se battre comme un Français » pour désigner un combattant lâche et maladroit ? De plus, à chaque fois qu’ils avaient été acculés, les combattants d’outre-manche avaient révélé le meilleur d’eux-mêmes et battus des troupes supérieures en nombre comme à Crécy, Poitiers ou Azincourt. Autant dire que les Anglais se sentaient sûrs d’eux.
Au moment où les deux armées se rencontrent devant le petit village de Formigny, le 14 avril 1450, le comte de Clermont se trouve devant un redoutable dilemme. Il a envoyé un messager au connétable de Richemont qui se trouve à Saint-Lô. Celui-ci devrait arriver avec 300 lances et 800 archers (à peu près 2000 hommes). Avec ces renforts, il pourrait livrer un combat égal. D’un autre côté, Kyriel pourrait se remettre en marche et atteindre Caen pour renforcer l’armée de Somerset avant la venue des renforts. Finalement, il semble que le lieutenant général de Normandie cède à sa troupe avide de combat et ordonne que l’on se mette en ordre de bataille.
Le combat commence le 15 avril 1450. Le dispositif de Thomas Kyriel est une copie conforme de celui des grandes victoires anglaises. La veille, il a fait creuser des tranchées et planter des épieux. Son armée est adossée à des vergers de pommiers qui empêchent qu’elle ne soit pris à revers. Son plan est simple. Il va attendre la charge indisciplinée de la chevalerie française. Incapables de forcer le barrage des épieux, les chevaliers seront décimés par ses archers. Il ne restera alors plus qu’à profiter de la panique pour porter un coup décisif. Clermont, qui espère toujours voir arriver Richemont, hésite à engager le combat jusque vers midi. Durant toute la matinée, les deux armées s’observent. Finalement, Clermont ordonne à l’artillerie d’ouvrir le feu. Ces pièces- des petits calibres- déciment les archers de Kyriel. Dans la panique, les Anglais font charger leurs 600 cavaliers pour prendre les couleuvrines.
Ce qui se passe ensuite devient confus car les chroniqueurs cessent de s’accorder sur le déroulement des événements. En tout cas, Français et Anglais se retrouvent en pleine mêlée alors que Richemont arrive enfin sur le champ de bataille. L’intervention est décisive. Les Anglais tentent de se replier mais se font tailler en pièce par les paysans des environs qui se joignent à l’hallali. Une juste rétribution de l’occupation anglaise qui fut particulièrement dure : expropriation, humiliations, lourds impôts, répression meurtrière...
A tout point de vue, Formigny est comparable Azincourt. Dans les deux cas, on voit une armée inférieure numériquement affronter un adversaire confit dans ses traditions militaires et incapable de s’adapter à une nouvelle manière de faire la guerre. Les pertes du vainqueurs sont très faibles (12 Français à Formigny), celles du vaincus catastrophiques (3 774 morts anglais, 1000 prisonniers dont Kyriel lui-même et de nombreux chefs de guerre). Ce qui change entre Azincourt et Formigny, c’est que vaincus et vainqueurs ont échangé leurs places. De manière bizarre, la plus grande victoire française de la guerre de cent ans reste très peu connue. Peut-être parce que – comme le veut l’adage- à vaincre sans péril on vainc sans gloire. Ce qui est pourtant très largement méconnaître l’incroyable réorganisation de l’armée française qui a permis en moins de dix ans de la faire passer d’un ramassis de mercenaires au plus puissant corps militaire de son époque.
Si Formigny est le joyau de la reconquête de Normandie ce ne dois pas cacher que la campagne elle-même est le chef d’œuvre de la vie de Charles VII.
Depuis des années, le roi de France repoussait toutes tentatives de reprendre les hostilités et avait habilement reconduit la trêve en dépit d’accrochages avec les Anglais. Charles VII – en diplomate habile- attendait une occasion qui lui permettrait d’être de manière absolue dans son bon droit. C’est alors que François de Surienne, un capitaine anglais, s’empare de Fougère par surprise. En tant que suzerain du duc de Bretagne, le roi de France se devait de réagir.
A écouter les atermoiements diplomatiques de Charles VII (violemment critiqués par le dauphin) on pourrait croire que le roi hésita longuement. C’est faux, depuis deux ans il écrivait des lettres à destination des villes de France pour les préparer à la reconquête de la Normandie. Il a seulement feint de rechercher une issue pacifique pour pouvoir entrer en guerre dans une position morale, de protecteur et de libérateur… une magnifique arme politique à usage interne comme externe. Ces hésitations avaient aussi pour but de renforcer la confiance des Anglais en eux-mêmes. Comme on peut le voir plus haut, cela les conduisit à une sous-estimation fatale du potentiel de leur ennemi.
Du point de vue tactique et stratégique, la campagne de Normandie fut absolument brillante. On notera la division de l’armée royale en trois corps (Bretagne, Picardie, Seine) et leur convergence vers Rouen. Les sièges seront plus souvent réglés par la diplomatie que par des coups de canons ce qui économisera temps, vies et munitions tout en renforçant le caractère « pacifique » de la reconquête. Le roi offrait à chaque garnison l’opportunité d’abandonner la place avec armes et bagages plutôt qu’une mort inutile. Lorsque les places résistaient sa puissante artillerie réglait le problème en quelques semaines.
En tout, la campagne dura trois cent soixante et onze jours. Selon les normes de l’époque c’est une véritable guerre éclair ! Pas un château, pas une ville n’est restée aux mains des Anglais à l’exception des îles de Jersey et Guernesey.
Alors oui, les batailles médiévales ne regroupent pas énormément de monde. Il faut savoir que la garnison moyenne d'un château est de 40 hommes. Un petit seigneur n'a que cela, un grand seigneur avec 100 châtellenie a peut-être 4000 soldats, dont la moitié seulement est mobilisable au combat.
La bataille d'Hasting a dû regrouper 20 à 22 000 combattants. Azincourt c'était 30 000 à 50 0000 tout compris. Le siège d'Orléans 17 000 hommes.
L'honneur n'est qu'un bien personnel, le plus précieux, certes. Mais l'honneur n'est pas une qualité pour l'exercice de cet art délicat qu'est la guerre.